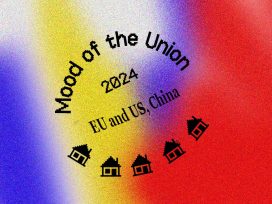Parce qu’il est d’une irréprochable honnêteté intellectuelle et ne cache rien d’essentiel, le livre consacré par Benoît Lechat à l’histoire d’Écolo invite à se poser ces questions et contient quasi tous les éléments pour y répondre. Plus encore, il incite à tenter d’y répondre sans tourner autour du pot, ni prendre des gants, avec un triple risque assumé: d’abord celui d’être réducteur, puisque tout est toujours plus compliqué bien sûr, ensuite celui d’être partial, puisqu’il s’agit en quelque sorte ici d’adopter le point de vue de l’adversaire, enfin celui d’être anachronique, puisque l’histoire que Lechat raconte et dont il rend compte dans ce premier tome s’arrête en 1986, à l’époque où Écolo n’était encore qu’aux portes du pouvoir gouvernemental, et que ce qui était vrai “avant” n’est plus forcément aussi vrai “après”.
Pourquoi tant de haine?
D’une manière générale et pour des raisons qu’il est inutile de développer, les fractions plutôt aisées de la classe moyenne, composées notamment de patrons de PME, de cadres du privé, d’indépendants et de représentants des professions libérales, ne portent pas les socialistes et les syndicalistes dans leur cur. En prétendant protéger les travailleurs au moyen notamment de l’impôt, l’action des uns et des autres serait un frein à la rentabilité et à la compétitivité des entreprises, à la prospérité de la nation et, en définitive et paradoxalement, à l’emploi même de ces travailleurs. On aime rarement les socialistes et les syndicalistes, on préfère voir les premiers dans l’opposition et on cherche à contenir l’influence des seconds. On ne les aime pas, mais on fait avec. Depuis le temps qu’on a appris à faire avec! S’ils gênent, ils ne remettent pas fondamentalement le système en question, ils n’empêchent pas les mieux nantis de consommer ce qu’ils veulent, de circuler dans leurs grosses autos, de chauffer leurs grandes piscines et de voyager aux quatre coins du monde, ils les y encouragent même d’une certaine façon, puisque la croissance est le sein auquel les uns et les autres s’allaitent sans jamais être sevrés, et qu’ils ont besoin les uns des autres. Pour faire très – trop – court, socialistes et syndicalistes souhaiteraient “seulement” – ce n’est déjà pas si mal – que les plus nantis soient un peu plus partageurs et ne jouent pas à leur gré avec le destin et les conditions d’existence de ce que le management a l’indécence d’appeler désormais les “ressources humaines”. Au fil de l’histoire et au gré des coalitions gouvernementales, les socialistes sont devenus des partenaires politiques du centre et du centre-droit, et les syndicalistes des interlocuteurs des patrons; entre les uns et les autres, l’hostilité et l’amertume sont plutôt contenues. Juste un peu-beaucoup-pas du tout d’animosité de temps à autre, selon les coalitions au pouvoir, avant qu’on ne parvienne à un énième compromis. Car chacun sait faire des compromis – ce serait même une belge spécialité – tant que les autres ne se mêlent pas de la manière dont il vit. Car ça, ça ne regarde que lui.
Avec les Verts, c’est tout différent. Il y a chez eux quelque chose – et même un peu plus – qui indispose littéralement les fractions plutôt nanties de la classe moyenne, même si ces dernières sont globalement d’accord avec eux pour reconnaitre les menaces qui pèsent sur la planète et les hypothèques mises sur la vie des générations futures. Qu’est-ce qui, chez les Verts, irrite à ce point ceux qui ont le cur plutôt à droite et suscite des propos véhéments dès que ceux-ci se retrouvent entre eux?
Que promettent les Verts à celles et ceux qui se projettent dans la vie animés d’un idéal moderne de dépassement continu de soi-même et des autres, de prospérité et d’amélioration insatiable de leur condition matérielle, de jouissance des plaisirs de la vie (considérés comme amplement mérités par un travail acharné), de découverte à très grande vitesse du monde lointain, de “Liberté” en somme? Que leur promettent les Verts sinon l’exact opposé? Le renoncement à… ou, du moins, la limitation de tout ce pourquoi on a travaillé et vécu jusqu’ici, assorti de surcroit d’une solide et insupportable dose de moralisme et de culpabilisation. Son empreinte carbone suit désormais partout le voyageur, les radars traquent les automobilistes qui ont tort de ne pas se mêler au commun dans les métros et les trains (qui arrivent rarement à l’heure lorsqu’ils ne restent pas au dépôt), la TVA sur les équipements individuels punit ceux qui ne veulent pas partager “en communauté” une même machine à laver avec leurs voisins de palier, les tendeurs et chasseurs sont devenus les gibiers des protecteurs des oiseaux migrateurs et des hôtes de la forêt, les pets mêmes des bovins responsables du réchauffement climatique empestent la conscience des amateurs de barbecues estivaux. Aucun domaine n’échappe à l’insatiable “pulsion règlementaire” des Verts qui veulent partout “”restreindre”, “inverser”, “prévenir”, “réguler” et “contraindre”“. Jusqu’au ridicule et morose – demandez aux fans de feu Dardenne – lorsqu’ils exigent des réunions officielles sans alcool. Rencontrer un Vert est comme se cogner à un grand panneau “Stop“, qu’ils n’appliquent évidemment pas à leurs propres murs libertaires (comme fumer des joints, encourager l’amour libre et l’homosexualité) et anarchiques (comme bruler les feux et rouler sur les trottoirs à vélo au grand dam des piétons). S’ils irritent tant, si on leur prête volontiers les traits de moralisateurs intégristes et irresponsables, c’est, pour une large part, parce que la remise en question qu’ils réclament va bien au-delà de l’environnement et du modèle de croissance économique et industrielle; comme le proclamait dès 1978 Paul Lannoye, elle porte sur le modèle culturel actuel que les classes sociales aisées incarnent forcément plus que les autres. Il ne s’agit pas seulement de renoncer à la croissance de la production et de la consommation, mais, plus fondamentalement encore, à un mode de vie, à un mode de socialité, à un système de valeurs et aux finalités mêmes de l’existence. On ne renonce jamais de gaité de cur à ce qu’on aime, au confort matériel et culturel dans lequel on s’est complaisamment installé et, plus encore, aux certitudes sur lesquelles on a construit sa vie. On y renonce d’autant plus difficilement qu’on est les premiers bénéficiaires de cette culture et de ce modèle de développement. C’est sans doute la principale raison pour laquelle ces fractions de classe moyenne aisée ne portent pas les Verts dans leur cur.
Il est une autre raison, plus insidieuse, à caractère sociologique. Ces Écolos qui condamnent des modes de vie et des valeurs principalement portés par les fractions plutôt supérieures de la classe moyenne en sont eux-mêmes, pour partie et aux premières décennies surtout, les enfants. Des enfants ingrats en somme, qui crachent sur la prospérité de leurs parents grâce à laquelle ils ont pu faire de belles études, acquérir des ressources culturelles et sociales, une capacité de prendre voix dans l’espace public, bref un habitus de classe moyenne… contestataire. Avec l’impitoyable lucidité volontairement réductrice qu’il déploie dans La Distinction , Bourdieu verrait même en une grande partie d’entre les Verts des années 1960-1980 – ceux dont Benoît Lechat narre l’aventure – des rejetons d’une (petite et moyenne) bourgeoisie en déclin, qui ont hérité de leurs parents moins de ressources économiques que de ressources culturelles, mais qui ont su exploiter ces dernières pour se faire une place dans les secteurs non marchands de la société: l’éducation, la création culturelle alternative, la recherche en sciences humaines… et la politique.
Filles et fils indignes de parents plutôt prospères et méritants, objecteurs de conscience dans tous les domaines possibles, les Verts n’en restent pas moins des “bourgeois gauchistes” et des “intellectuels” bavards aux yeux des classes populaires qui ne se reconnaissent pas le moins du monde dans les discours et les interminables discussions procédurales des Écolos, alors que le monde économique et social qui leur fournissait leur pain quotidien est en train de s’effondrer. Si les Verts sont coupés du “peuple d’en haut”, ils le sont tout autant du peuple d'”en bas”.
Sans relais institutionnels puissants, sans “base populaire”, sans réserve électorale consistante qui verrait un intérêt clair et direct à voter pour eux, confrontés au contraire à des groupes sociaux qu’ils importunent, les Verts incarnent une tendance qui tenterait (en vain) de “sauter par-dessus le réel pour arriver directement à ses fins“. Là réside un des nuds du problème: quel est le réel social et sociologique sur lequel les Verts peuvent s’appuyer, qu’ils peuvent fidéliser et mobiliser durablement? Dans quelle pâte sociale peuvent-ils agir comme des enzymes capables de la faire fermenter? Une pâte existe, mais elle est encore trop légère et versatile, essentiellement quelques fractions de classe moyenne diplômées, qui entendent cultiver des valeurs d’autonomie, de démocratie, de respect de l’environnement, de justice sociale et de solidarité dans une atmosphère conviviale. Bref, les Verts n’ont guère de réel social consistant en connivence avec lequel ils peuvent poursuivre les fins qu’ils se donnent.
Encore faut-il qu’ils aient des fins à proposer, susceptibles de mobiliser et de rassembler. Mettre des limites et renoncer d’accord, mais renoncer pour quoi d’autre? La force des Verts est leur capacité de dire clairement, de manière convaincante et substantielle ce qu’ils ne veulent plus; leur faiblesse est leur difficulté à dire clairement, de manière convaincante et substantielle ce qu’ils veulent. En tout cas, à le dire suffisamment fort et concrètement pour le “vendre” à une partie appréciable de la population qui constituerait une base électorale solide, étendue et stable, comme en bénéficient ou en ont bénéficié les partis dits traditionnels.
Le projet des Verts est doublement négatif, tel qu’il est perçu et, sans doute pour une large part, intrinsèquement. Il est négatif tout d’abord dans la mesure où ses finalités sont essentiellement définies négativement: empêcher la détérioration de la nature et du cadre de vie, inverser la croissance, mettre un terme à un mode de développement. Le projet vert est non téléologique: il s’agit moins de viser le meilleur, qui n’est pas suffisamment défini, que d’éviter le pire. Cette caractéristique inscrit bien le projet vert dans la “société du risque” qu’Ulrich Beck voit comme une expression particulièrement pointue de la modernité réflexive. La société du risque n’est plus confrontée d’abord à la nature dont il s’agirait de se protéger (les catastrophes naturelles) et qu’il s’agirait de domestiquer (l’industrialisation), au monde qu’il s’agirait de conquérir (les grandes découvertes et la colonisation), bref à quelque chose d’extérieur à elle, mais, au contraire, à elle-même, aux conséquences de son propre développement qu’elle ne maitrise plus. Quelle pourrait être aujourd’hui une telle fin positive et substantielle qui submergerait dans les curs et les esprits ce sentiment de proposer surtout des limitations (mêmes nécessaires)?
Comme on l’a vu, le projet vert est négatif aussi au sens foucaldien du terme, car il exprime en grande partie une forme de pouvoir faite d’interdictions, d’obligations, de règlementations, d’empêchements de faire, en opposition à sa forme positive qui encourage, mobilise, et fait faire. Fondamentalement, tout cela n’est guère excitant et ne peut reposer que sur des militants qui, loin d’espérer un avantage personnel ou collectif particulier (en dehors des satisfactions qu’apporte l’action collective en elle-même), sont disposés à lutter dans l’intérêt général, en ce compris celui de leurs propres adversaires et à assumer le rôle ingrat d’empêcheurs de produire et de consommer sans limite.
Les deux aspects sont liés. Prévenir le mal est une chose, créer le bien en est une autre, pense Ulrich Beck qui soutient que “C’est la notion de limite qui a limité, voire tétanise la politique verte”. À ses yeux, manque de réel social et absence de finalité positive sont problématiquement liés: le discours vert est d’autant plus étranger aux peuples, aux citoyens – il ne s’adresse qu’aux experts et aux élites – qu’il ne leur propose pas de finalités concrètes transposables en objectifs où ces peuples et ces citoyens peuvent discerner un sens et surtout un intérêt. D’où l’importance, estime Beck, de penser le développement de l’écologie politique dans une perspective sociologique.
Comment faire de la politique quand on la déteste?
On objectera que le livre de Benoît Lechat souligne avec force que les Verts poursuivent une fin positive: la démocratie radicale définie par un ensemble de caractéristiques (l’autonomie des communautés de base, l’autogestion, la participation des personnes concernées et la délibération entre elles à tous les niveaux de pouvoir, le contrôle des délégués par la base…), soutenues par une utopie libertarienne qui suppose une harmonisation spontanée des décisions autonomes locales. Il interprète d’ailleurs très pertinemment l’histoire d’Écolo comme la tentative de surmonter la tension entre les objectifs de démocratie radicale et de “respect des équilibres écosystémiques“. La mise en uvre intégrale de la démocratie radicale peut en effet conduire à des décisions démocratiques que contesteraient les experts parce qu’elles iraient à l’encontre du respect des écosystèmes, ou, inversement, à des conclusions scientifiques qui ne seraient pas acceptées au terme de délibérations démocratiques. Mais la démocratie radicale présente cette ambigüité d’être indissociablement une fin et un moyen. La fin en laquelle elle consiste est de nature procédurale, méthodologique, elle n’est pas de nature substantielle, comme, il n’y a pas si longtemps, la construction d’un État-nation démocratique, l’industrialisation de l’économie, la construction d’une société à la fois économiquement prospère et socialement juste ou la conquête d’un empire colonial. Ce hiatus est bien perçu par Benoît Lechat: en réalité, ce qui caractérise le rapport du projet vert au temps, c’est la tension entre un présent concret défini positivement (la démocratie radicale immédiatement) et un futur idéal et abstrait, par ailleurs défini surtout négativement (ce qu’il faut éviter).
Dans un langage wébérien, on pourrait dire que, pour les Verts, rationalité par valeur et rationalité par finalité se confondent. C’est pourquoi la démocratie radicale doit être mise immédiatement en uvre, sans le moindre délai et la participation citoyenne doit s’intégrer à l’activité politique. “Faire de la politique autrement” est un impératif “incontinent”. C’est tout de suite qu’il faut mettre un terme au clientélisme, au cumul des mandats et aux nominations partisanes, qu’il faut instaurer la transparence et la participation. En commençant chez soi, dans son propre parti.
La “méthode-fin” se réalise à tous les niveaux. À celui des “communautés de vie”, l’autogestion, cet “exercice réellement collectif de la liberté, de la responsabilité, de la décision et du pouvoir” est immédiatement de rigueur car ces communautés ont le droit de décider de leur propre sort. D’un point de vue personnel, les individus doivent se libérer de l’imaginaire de la croissance et de la consommation pour adopter un mode de vie écologique et “se réapproprier leur vie tout en se retrouvant dans un “destin” commun“.
Toutefois, on peut se demander si l’exigence vertueuse de démocratie radicale n’est pas pervertie par la difficulté de définir et de faire valoir des fins substantielles. Lorsque les fins sont inaccessibles, éloignées et abstraites, définies surtout négativement, tandis qu’en revanche, les moyens sont immédiatement applicables, concrets et définis positivement, la tentation peut être grande de substituer les moyens aux fins, à fortiori lorsque la distinction entre fins et moyens tend déjà à s’estomper (comme c’est le cas pour la démocratie radicale). Les vertus mêmes du projet de la démocratie radicale (l’autogestion, la participation…) sont alors exacerbées en des formes quasi monstrueuses, notamment l'”acharnement procédural” et la “pulsion participative [qui] semble parfois n’avoir d’autre fin qu’elle-même” et qui conduisent à d’interminables discussions et à d’incessantes remises en cause de ce qui vient d’être décidé, la peur obsessionnelle de la concentration du pouvoir, la défiance à l’égard des élus qui ne sauraient être que les porte-paroles du collectif et les exécutants de ses décisions, l’ascétisme imposé aux mandataires (qui rétrocèdent déjà la moitié de leurs indemnités parlementaires), la condamnation de toute forme de personnalisation jusqu’au découragement des plus brillants … Ce qui est au départ vertueux se dégrade en un ritualisme des moyens d’autant moins accepté qu’il est exploité à géométrie variable selon les ambitions personnelles et les rapports de force internes, en contradiction avec les principes mêmes de la démocratie radicale. Qui fait l’ange…
Conçue dans sa pureté même, la démocratie radicale constitue l’antithèse de la politique telle qu’elle fonctionne le plus souvent. Activité quotidienne des hommes et des femmes politiques confrontés à la nécessité permanente de décider, la politique met les mains dans le cambouis et exige d’arbitrer et de trancher entre valeurs antagonistes; à distinguer les valeurs politiques (comme la responsabilité et le courage) et les valeurs morales (comme l’honnêteté et la franchise); elle n’est possible qu’au prix de constants compromis entre partenaires-adversaires; elle se nourrit du clientélisme et de la complicité au sein de réseaux d’interdépendance; une certaine dose de personnalisation et de concentration du pouvoir est inévitable car le succès électoral du parti dépend directement de la notoriété de ses locomotives et de leur aptitude à se faire reconnaitre et admirer comme des “chefs” brillants, capables de décider et d’agir; la politique exige l’allégeance le plus souvent explicite des partisans aux leadeurs dont dépendent les mandats (généralement cumulés); les ordres viennent d’en haut et ne se discutent guère; la politique est affaire de camps et de clans entre lesquels la lutte est féroce, sur scène et en coulisse; la fin justifie les moyens; le processus de décision est moins important que son contenu et ce contenu est lui-même moins important que son annonce; les échéances électorales et la recherche de compromis à court terme comptent plus que l’avenir de la société… N’en déplaise aux belles âmes démocrates, Machiavel reste la référence implicite et le maitre à penser. Certes, il serait stupide, car faux et injuste, de dire qu'”ils sont tous pourris”; au contraire, il est étonnant de penser qu’autant d’hommes et de femmes “bien” en arrivent à devoir jouer un jeu qui l’est beaucoup moins, s’ils veulent parvenir à y obtenir quelque succès et quelque résultat.
La démocratie radicale prônée par les Verts réclame exactement l’inverse: l’intransigeance des valeurs morales qui prévalent sur les valeurs politiques, le refus des compromis, du cumul des mandats et du clientélisme, elle est foncièrement anti-élitiste et opposée à la vénération des chefs qui doivent être contrôlés en permanence et à la concentration du pouvoir; résultats d’un long processus de discussion et de maturation, les “ordres” viennent d’en bas; le processus de décision importe plus que le contenu; la transparence et la participation sont de mise à tous les niveaux… L’utopie est louable, et il ne faudrait pas trop vite renoncer avec fatalisme à une certaine éthique politique. Mais elle est d’autant plus difficile à concrétiser qu’Écolo n’est pas davantage que les autres partis, épargné par les petits calculs et les querelles intestines. Et elle est d’autant plus difficile à (faire) avaler qu’Écolo prétend davantage que ces autres partis à la vertu.
À ce stade, il y a plus de questions que de réponses. On pourra d’autant plus compter sur le second tome du livre de Benoît Lechat pour y voir plus clair qu’il avait déjà posé dans son premier volume la question de l’adéquation entre le mouvement et ses représentants, comme celle de l’adéquation entre l’exigence de démocratie à la base et de l’organisation d’un gouvernement pluraliste.
Sur le plan de la méthode d’abord. Comment Écolo peut-il susciter une large adhésion et obtenir les suffrages de nombreux électeurs s’il n’assume pas les contraintes de la politique? À quoi peut-il renoncer pour cela et sur quels principes et règles doit-il rester ferme? Comment Écolo peut-il être désiré dans des coalitions quand son intransigeance morale et son exigence de participation à tous les étages énervent à ce point les partis potentiellement partenaires, rendus impatients? Comment Écolo peut-il être partie prenante du “système politique” et assumer concrètement des responsabilités politiques quand il ne veut pas être “récupéré par le système”? Jusqu’où peut-il peser pour modifier ce système sans s’en exclure? Comment la démocratie radicale peut-elle être compatible avec l’exercice du pouvoir aux différents niveaux de responsabilité? Comment faire vivre le projet démocratique dans un contexte qui n’est plus celui de l’État-nation et d’une relative homogénéité culturelle? Comment concilier la démocratie radicale et les observations scientifiques qui sortent des laboratoires des experts?
Sur le plan du contenu ensuite. Comment repenser les questions de société fondamentales – celles des inégalités, de l’inclusion et du pouvoir notamment – conjointement avec celles des changements qui touchent le climat, les ressources (l’énergie, l’eau, l’air…) et le cadre de vie? Quels concepts utiliser désormais qui ne piègent pas la pensée dans des impasses, comme celui
d’environnement?
Surtout peut-être: est-il possible de définir un projet mobilisateur et rassembleur sans utiliser une seule fois des mots comme “limite”, “prévention”, “régulation”, “interdiction”, “décroissance”? Chiche!