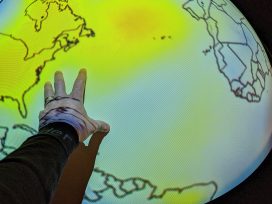Qu’une résistance à ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le “biopouvoir” – contrôle, régulation, exploitation et instrumentalisation du vivant – puisse provenir de possibilités inscrites dans la structure du vivant lui-même et non de concepts philosophiques qui la surplombent; qu’il puisse y avoir une résistance biologique à la biopolitique; que le “bio-” puisse être considéré comme une instance complexe et contradictoire, opposée à elle-même et désignant d’un côté le véhicule idéologique de la souveraineté moderne, de l’autre ce qui le freine, voilà qui semble n’avoir jamais été pensé.

“Vers le passé, puisque la régénération est une propriété très ancienne, attachée aux animaux primitifs, comme l’hydre, la planaire, l’étoile de mer.” Photo: Roger Jones. Source: Flickr
Le préjugé antibiologique de la philosophie
Qu’est-ce à dire? C’est un fait, notre époque a vu l’effacement définitif de la limite que l’on a cru assurée, pendant des siècles, entre sujet politique et sujet vivant. Foucault a mis en lumière de manière magistrale l’effacement de cette limite, effacement qui marque la naissance de la biopolitique et forme le trait caractéristique de la souveraineté moderne:
L’homme, pendant des millénaires, est resté ce qu’il était pour Aristote: un animal vivant et de plus capable d’une existence politique; l’homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d’être vivant est en question.
Ces propos célèbres caractérisent le biopouvoir comme le dispositif d’introduction de la vie “dans les mécanismes politiques”. Le pouvoir s’exerce, au seuil de la modernité, sur les “processus de la vie” et entreprend de les “contrôler et de les modifier”. Giorgio Agamben, dans Homo sacer, reprend l’analyse de cette zone d’indifférenciation entre vie biologique et vie politique qui définit désormais l’espace de la communauté. Le vivant est définitivement entré en politique.
Force est de remarquer toutefois que cette “entrée” est unilatérale, non dialectique, sans retournement. Le “double processus croisé de la politisation de la vie et de la biologisation du politique” a lieu sans tension puisque le biologique est privé de droit de réponse et semble se couler sans plus dans le moule du pouvoir. Tout se passe comme si la biologie se préparait dès sa naissance, au XVIIIe siècle, à son investiture politique en prêtant au pouvoir des catégories transfuges. En effet, les “concepts biologiques” ont tous, selon Foucault, un “caractère compréhensif et transférable” par où ils excèdent leur signification technique pour prendre un sens normatif. Or le devenir politique des concepts biologiques ne va que dans un sens, celui du contrôle, de la régulation des individus comme des populations. Il semble établi qu’il ne puisse exister de résistance biopolitique à la biopolitique.
Giorgio Agamben, en radicalisant ce point de vue, n’hésite pas à dire que le nazisme n’a même pas eu besoin d’adapter les concepts génétiques à ses fins; ils étaient en quelque sorte prêts à l’emploi:
Contrairement à un préjugé très répandu le nazisme ne s’est pas contenté d’utiliser et de déformer les concepts scientifiques dont il avait besoin pour servir ses propres fins politiques; le rapport entre l’idéologie national-socialiste et le développement des sciences biologiques de l’époque, plus particulièrement celui de la génétique, est non seulement plus profond et complexe, mais aussi plus inquiétant.
Dans la même perspective, Roberto Esposito n’hésite pas à écrire que le nazisme “est une biologie réalisée”.
Une telle manière de penser laisse à l’évidence sur le bord du chemin tout ce qui, dans la biologie, n’a trait ni au dressage des corps ni à la régulation des conduites, mais révèle la réserve de possibles inscrite dans le vivant lui-même. Une dimension qu’attestent les découvertes révolutionnaires de la biologie moléculaire et cellulaire aujourd’hui. Ces découvertes, qui demeurent pour une grande part ignorées des philosophes, sont précisément susceptibles de renouveler la question politique. On peut le démontrer à partir de deux catégories centrales. La première est celle d’épigénétique. La seconde celle de clonage selon ses deux champs opératoires: la reproduction asexuée et la régénération, ou auto-réparation.
Nous avons bien conscience de traiter là avec des notions explosives, qui apparaissent le plus souvent comme les outils privilégiés de la biopolitique contemporaine et de ses dérives à la fois industrielles, biologistes ou eugénistes. Pourtant, nous maintenons que ces catégories permettent de remettre en question le préjugé antibiologique de la philosophie.
Quel est ce préjugé? La philosophie contemporaine porte la marque de la prééminence non critiquée et non déconstruite de la vie symbolique sur la vie biologique.
La vie symbolique est celle qui excède la vie biologique, lui confère un sens. Elle désigne la vie spirituelle, la vie “oeuvre d’art”, la vie comme souci de soi et façonnement de l’être, qui décolle notre présence au monde de sa seule dimension naturelle et obscure.
Les concepts de corps chez Foucault, celui de vie nue chez Agamben, témoignent de ce dédoublement non questionné du concept de vie. Ils expulsent paradoxalement le biologique censé constituer leur coeur – lequel devient de ce fait leur impensable résidu.
Reprenons de nouveau la phrase de l’Histoire de la sexualité: “L’homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d’être vivant est en question.” Rapidement, Foucault identifie la “vie d’être vivant” au corps:
Le but de la présente recherche est […] de montrer comment des dispositifs de pouvoir s’articulent directement sur le corps.
Le corps a valeur de trait d’union entre “l’anatomie, le biologique, le fonctionnel” et apparaît comme le plus petit dénominateur commun aux diverses déterminations censées qualifier la “spécificité de vivant”: “fait de vivre”, “être membre d’une espèce vivante dans un monde vivant”; avoir des conditions d’existence, des probabilités de vie; une santé, individuelle et collective.
Or on s’aperçoit vite que le corps est en réalité 1) tout et partie d’une liste où le biologique se définit de façon éparse: “corps, fonctions, processus physiologiques, sensations, plaisirs”, ou encore: “organes, localisations somatiques, fonctions, systèmes anatomophysiologiques, sensations, plaisirs”; 2) qu’il est et n’est pas réductible au biologique. Ce dernier est dit être “ce qu’il y a de plus matériel, de plus vivant” dans les corps. Que doit-on comprendre? Qu’il y a du plus et du moins vivant, du plus et du moins matériel dans le corps? Si oui, cela signifie alors que le “moins vivant” et le “moins matériel” est ce qui, dans le corps, est incorporel: le spirituel, ou le symbolique.
Même problème avec la “vie nue”, que Giorgio Agamben emprunte à Benjamin (bloss Leben) et qu’il constitue en catégorie centrale de son analyse de la biopolitique. À bien des égards, la vie nue semble se confondre avec la vie biologique. Elle renvoie au “simple fait de vivre”, désigne la “vie naturelle” (pour laquelle il n’y a pas le bien et le mal mais “l’agréable et le douloureux”), “la vie biologique comme telle”. Elle est souvent qualifiée de “pure” ou de “simple”: “simple fait de vivre”, “simple vie naturelle”. Mais elle peut être aussi synonyme de corps: “simple corps vivant”, corps docile (“le pouvoir pénètre dans le corps des sujets”). Mais on retrouve ici le même flou: “La vie nue, écrit Agamben, habite dans le corps biologique de chaque vivant.” Il y a donc, là encore, de l’espace pour autre chose que la vie nue dans le corps biologique. Et en quoi consiste alors ce qui n’est pas la vie nue dans ce corps? On le comprend, la vie nue est ce qui habite dans le corps biologique sans être réductible à lui – son symbole.
Les biologistes, remarquons-le, ne nous aident pas sur ce point. Aucun d’entre eux n’a jugé utile de répondre aux philosophes et de lever l’assimilation entre biologie et biologisme. Il paraît impensable qu’ils ne connaissent pas Foucault, qu’ils n’aient jamais rencontré le mot de biopolitique… Fixés sur les deux pôles de l’éthique et de l’évolutionnisme, ils ne mènent pas de réflexion sur la manière dont la science du vivant pourrait et devrait désormais inquiéter l’identité entre détermination biologique et normalisation politique. Le bouclier éthique dont s’entoure le discours biologique aujourd’hui ne suffit pas à délimiter l’espace d’une désobéissance théorique aux accusations de complicité entre science du vivant, capitalisme et manipulation technologique de la vie.
L’écart entre le vivant et lui-même
Il convient donc, pour poser enfin les bases de la discussion, de demander à la biologie contemporaine la “permission”, pour reprendre une expression de Canguilhem, de dégager ses “concepts fondamentaux”.
Épigénétique et clonage sont de tels concepts, liés par un ensemble de relations complexes, qui situent le vivant comme centre d’interactions.
Dans le premier cas (épigénétique), les interactions ont lieu entre deux systèmes de transmission de l’information héréditaire tant au niveau du développement individuel (développement onto-génétique) qu’au niveau de la perpétuation des caractères de l’espèce (hérédité phylogénétique). Dans le second cas (clonage), les échanges ont lieu entre deux régimes de reproduction, procréation et transfert de noyau. Chacun de ces deux cas fait apparaître le vivant comme une structure ouverte où se croisent des régimes pluriels de transmission de la mémoire et du patrimoine. Il faut penser “ce qu’il y a de plus vivant et de matériel dans les corps” comme un espace de jeu, un dynamisme formatif et transformatif de l’identité organique qui opère dans l’économie du vivant elle-même et non hors de lui. L’écart ouvert entre le vivant et luimême par la double interface entre régimes de transmission et régimes de reproduction est un écart mémoriel paradoxal en ce qu’il révèle la mouvance désormais fondamentale entre irréversibilité et réversibilité de la différence.
L’épigénétique
L’épigénétique permet tout d’abord de remettre en question la définition du vivant comme ensemble de fonctions; elle permet ensuite de remettre en question la définition du vivant comme programme; enfin, elle brouille la ligne de partage entre fait de vivre et élaboration d’un mode d’être. Le mot “épigénétique” provient du nom “épigenèse” (du grec epi, au-dessus de, à côté, et genesis, genèse; epi-genesis signifiant alors littéralement “au-dessus ou à côté de la genèse”), apparu au XVIIe siècle pour désigner une théorie biologique qui affirme que l’embryon se développe par différenciation successive de parties et s’oppose ainsi au préformationnisme. Ce dernier présuppose à l’inverse que l’organisme vivant est intégralement constitué d’avance, comme en petit, dans le germe.
Il reste quelque chose de l’épigenèse dans l’épigénétique contemporaine puisque celle-ci est une science qui a bien pour objet un certain type de développement progressif et différencié. Le terme est employé pour la première fois par Conrad Waddington en 1941 pour désigner le domaine de la biologie qui traite des relations entre les gènes et le phénotype, ou ensemble des caractères observables d’un individu, dont ils sont responsables. On appelle ainsi épi-génétique l’étude des changements héréditaires et réversibles dans la fonction des gènes ayant lieu sans altération de cette séquence. Depuis les années 1970, le terme s’applique à l’ensemble des mécanismes qui contrôlent l’expression génétique via la transcription par l’ARN et modifient l’action des gènes sans modifier la séquence ADN. Principalement connu pour son rôle de messager, qui transfère l’information génétique de l’ADN vers les usines de fabrication des protéines situées à l’extérieur du noyau de la cellule, l’ARN est de plus en plus reconnu comme étant un acteur clé de l’histoire épi – génétique. Mais qu’appelle-t-on “histoire épigénétique”?
Il s’agit d’abord d’une dimension essentielle du développement ontogénétique. Thomas Morgan exprimait déjà la nécessité d’avoir recours aux phénomènes épigénétiques pour comprendre le développement individuel:
Si les caractères de l’individu sont déterminés par les gènes, demandait-il, pourquoi toutes les cellules d’un organisme ne sontelles pas identiques?
Chaque cellule d’un même organisme ayant un même patrimoine génétique, il faut supposer l’existence d’une expression différentielle des gènes. Les mécanismes épigénétiques constituent cette expression, qui concerne essentiellement la différenciation cellulaire et la méthylation de l’ADN via l’ARN, laquelle favorise ou au contraire affaiblit la transcription du code.
La notion d’histoire épigénétique renvoie en second lieu à un type d’hérédité, c’est-à-dire là encore à une modalité spécifique de transmission de l’information d’une génération à l’autre, d’où l’importance de sa dimension phylogénétique. Dans leur ouvrage Evolution in Four Dimensions, Eva Jablonka et Marion Lamb, qui vont jusqu’à parler du “tournant épigénétique” de notre époque, insistent sur le fait que la transmission génétique n’est pas le seul mode de transmission héréditaire:
L’idée que seul l’ADN est responsable des différences héréditaires entre les individus est maintenant si solidement ancrée dans les esprits qu’il est difficile de l’en effacer. L’idée que l’information transmise à travers des systèmes d’hérédité non génétique est d’une importance capitale pour comprendre l’hérédité et l’évolution n’est pas encore admise.
Pourtant, l’hérédité épigénétique est aujourd’hui incontestable. Les modifications épigénétiques ont en effet la particularité d’être héritables d’une génération de cellules à l’autre, ce qui complexifie l’idée d’évolution et révèle la multiplicité de ses “dimensions”.
La notion d’histoire épigénétique renvoie enfin à la manière dont les modifications du patron des gènes dépendent non seulement de facteurs internes et structuraux, comme ceux que nous venons d’évoquer, mais encore de facteurs environnementaux.
L’épigénétique en effet fournit aussi au matériel génétique un moyen de réagir à l’évolution des conditions environnementales. Bien que les plantes n’aient ni système nerveux ni cerveau, leurs cellules ont la faculté de mémoriser les changements saisonniers. Chez les animaux, les réactions aux conditions environnementales sont plus grandes encore. Des études de laboratoire sur des souris consanguines ont récemment démontré qu’un changement de régime alimentaire peut influencer leur progéniture. Les petits peuvent avoir un pelage brun, jaune ou tacheté en fonction de ce changement. Lorsque les femelles en gestation reçoivent une certaine alimen – tation, leur progéniture développe surtout un pelage brun. La plupart des petits mis au monde par des souris témoins (qui n’avaient pas reçu de compléments) ont un pelage jaune ou tacheté. Il y a donc une mémoire transmissible des changements dus au milieu.
Comme l’affirme Thomas Jenuwein, directeur du département d’immunobiologie de l’institut Max Planck:
On peut sans doute comparer la distinction entre la génétique et l’épigénétique à la différence entre l’écriture d’un livre et sa lecture. Une fois que le livre est écrit, le texte (les gènes ou l’information stockée sous forme d’ADN) sera le même dans tous les exemplaires distribués au public. Cependant, chaque lecteur d’un livre donné aura une interprétation légèrement différente de l’histoire, qui suscitera en lui des émotions et des projections personnelles au fil des chapitres. D’une manière très comparable, l’épigénétique permettrait plusieurs lectures d’une matrice fixe (le livre ou le code génétique), donnant lieu à diverses interprétations, selon les conditions dans lesquelles on interroge cette matrice.
Le vivant n’exécute pas simplement un programme. Si la structure du vivant est un point de croisement entre un donné et une construction, il devient difficile d’établir une frontière stricte entre nécessité naturelle et invention de soi.
Le clonage
Venons-en au clonage. Pour approcher ce dernier comme une catégorie conceptuelle nouvelle proposée à la pensée par la biologie contemporaine, il convient de revenir au problème, annoncé plus haut, du jeu entre réversibilité et irréversibilité de la différence. Un jeu qui “ébranle durablement nos conceptions sur le caractère irréversible des processus de différenciation cellulaire”.
Les premières recherches sur le clonage étaient bien destinées au départ à étudier les mécanismes de la différenciation cellulaire. Mais, de manière logique, la question d’une possible dédifférenciation des cellules s’est rapidement posée. Comme l’écrit Nicole Le Douarin:
Les expériences pionnières sur le clonage avaient pour but d’éclairer l’un des problèmes majeurs de la vie: comment se construisent les organismes multicellulaires dans lesquels la division du travail entre les cellules est la règle. La curiosité des biologistes les a évidemment amenés à se poser la question d’une généralité de ce phénomène. Les noyaux des cellules différenciées des organismes supérieurs tels que les mammifères sont-ils capables, comme ceux des amphibiens, d’être reprogrammés pour recouvrer l’état particulier et unique du noyau de l’oeuf?
Est-il possible, en d’autres termes, d’accéder à l’état premier de la cellule, au stade embryonnaire où les cellules ne sont pas encore spécialisées?
Les méthodes expérimentales qui auraient permis de répondre à cette question, poursuit l’auteure, n’étaient pas disponibles dans les années 1960. C’est plus tard que la culture de l’oeuf et de l’embryon de mammifère est devenue possible, ouvrant ainsi des voies de recherche d’un grand intérêt. Elle a permis l’avènement de bio – technologies qui ont abouti à la procréation médicalement assistée (PMA) chez l’homme, à la production des cellules souches embryonnaires dès 1981, au clonage de la brebis Dolly en 1996 et à celui de bien d’autres espèces de mammifères depuis.
Tentons de mettre un peu d’ordre dans cette liste en insistant sur deux opérations biotechnologiques effectuées sur la cellule: la production des cellules souches embryonnaires d’une part, base d’un premier type de clonage, dit clonage thérapeutique, et le clonage de mammifères d’autre part, dit clonage reproductif. Ces deux opérations prouvent la possibilité d’une réversibilité de la différenciation cellulaire et renversent ainsi un dogme jusqu’alors considéré comme définitif.
Le problème que pose le clonage à la catégorie de différence n’est pas d’abord celui de la copie, de la menace d’un éternel retour de l’identique. Le clone ne sera jamais une copie fidèle et parfaite:
L’épigenèse est un puissant déterminant du développement […] lorsqu’il s’agit de réguler le fonctionnement des gènes et l’établissement des réseaux neuronaux. Elle l’est encore plus en ce qui concerne le développement de la singularité, des aspirations et des talents de chacun. L’environnement dans lequel vit l’homme en devenir joue dans ce domaine un rôle considérable.
Si donc la possibilité de la reproduction par le clonage pose le problème de la différence, celui-ci n’est pas à chercher d’abord dans l’économie de la réplique. Le lieu du problème, au sein de la relation dialectique entre épigénétique et clonage, est davantage celui du caractère unidirectionnel et définitif de la différenciation cellulaire, du programme et de l’empreinte. L’enjeu, en d’autres termes, tient à la possibilité de remonter à un temps d’avant la différence.
En effet, la nouveauté radicale du concept de vivant élaboré aujourd’hui par la biologie tient paradoxalement au retour de potentiels cellulaires, présents chez les animaux primitifs et que l’on croyait disparus ou du moins amoindris chez les animaux dits “supérieurs”. Ces potentiels sont précisément la reproduction asexuée et la régénération. Ces dernières représentent d’anciennes formes de vie actualisées par les techniques de pointe que sont le clonage thérapeutique et le clonage reproductif. L’innovation biotechnologique, loin d’être une simple instrumentalisation, manipulation, mutilation, actualise ainsi une mémoire, celle des vivants effacés en nous. Le posthumain est aussi le préhumain. Sur cette dimension de retour de nature de la technique, aucun philosophe ne s’exprime jamais.
Réparer, régénérer: le jeu des possibles
La possibilité de réparer naturellement tout ou partie de son corps, la régénération, a été en grande partie perdue, au cours de l’évolution, chez les mammifères. C’est pourquoi la découverte des cellules souches, susceptibles de réparer, de reformer ou de régénérer des organes ou tissus lésés, imprime au regard une double direction, vers le futur et vers le passé tout ensemble. Vers le futur, c’est-à-dire vers la mise au point de techniques destinées à l’utilisation médicale de ces cellules. Vers le passé, puisque la régénération est une propriété très ancienne, attachée aux animaux primitifs, comme l’hydre, la planaire, l’étoile de mer.
À plusieurs égards, les avancées de la biologie font revenir, sur un mode renouvelé, un passé que l’on croyait révolu. Jean-Claude Ameisen interprète ce jeu de retour comme un jeu des possibles. Des possibles qu’il s’agit de “tirer de leur sommeil”:
[Nous] pourrons essayer de nous renouveler et de nous pérenniser à partir de nos propres cellules souches, à partir des spores qui dorment dans notre corps.
Il ajoute:
Les innombrables innovations du vivant se sont construites […] à partir de la répression – temporaire – de la plupart de leurs potentialités. Et la richesse de ces potentialités qui dorment au plus profond de notre corps dépasse sans doute de très loin ce que nous pouvons encore imaginer.
La réactualisation de vestiges phylogénétiques que l’on croyait à jamais disparus constitue le coeur de la recherche biologique contemporaine.
En quoi ce retour des possibles que nous venons d’évoquer peutil constituer une force de résistance? La résistance de la biologie à la biopolitique? Répondre à ces questions nécessite l’élaboration d’un nouveau matérialisme, qui affirme la coïncidence du symbolique et du biologique. Il n’y a qu’une seule vie.
Les potentiels biologiques révèlent des modes de transformation inédits: reprogrammation des génomes sans modification du programme génétique; remplacement tout ou partie du corps sans greffe ni prothèse; conception du soi comme source de reproduction… Ces opérations réalisent une véritable déconstruction du programme, de la famille et de l’identité qui menacent de fracturer l’unité supposé du sujet politique, de révéler le caractère imprenable car pluriel de sa “vie biologique”. L’articulation du discours politique sur les corps est toujours partielle, qui ne peut absorber tout ce que la structure du vivant est susceptible de faire éclater en révélant les possibilités d’un renversement de l’ordre des générations, d’une complexification de la notion d’héritage, d’une remise en cause de la filiation, d’un nouveau rapport à la mort et à l’irréversibilité du temps, par là d’une nouvelle expérience de la finitude.