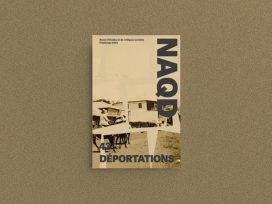
A common oppressor
NAQD 43 (2024)
The lurid past of French colonial expulsion and incarceration: of Algerians sent to French Guiana; Jews interned in camps termed ‘battalions’; and French colonized peoples replacing convicts as forced labour.
 En 1996, la municipalité de Cassis1 nouvellement élue, se rappelle qu’elle abrite sur son territoire un bidonville. Soucieuse de protéger son image et craignant surtout que ce bidonville de Tunisiens dont “on ne sait rien, si ce n’est qu’il fournit en jardiniers les coquettes villas de la commune”, ne serve à accueillir de nouveaux migrants, elle met en place une procédure d’enquête publique dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre. Cette procédure oblige la municipalité à faire appel à des bureaux d’études indépendants. C’est dans ce contexte, qu’il me fut demandé de mener une étude et de produire un rapport. Cet article, en s’appuyant sur une enquête menée durant 9 mois (de septembre 1996 à avril 1997) se propose d’apporter un témoignage de terrain sur le vécu d’une immigration dans un des derniers bidonvilles de France.
En 1996, la municipalité de Cassis1 nouvellement élue, se rappelle qu’elle abrite sur son territoire un bidonville. Soucieuse de protéger son image et craignant surtout que ce bidonville de Tunisiens dont “on ne sait rien, si ce n’est qu’il fournit en jardiniers les coquettes villas de la commune”, ne serve à accueillir de nouveaux migrants, elle met en place une procédure d’enquête publique dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre. Cette procédure oblige la municipalité à faire appel à des bureaux d’études indépendants. C’est dans ce contexte, qu’il me fut demandé de mener une étude et de produire un rapport. Cet article, en s’appuyant sur une enquête menée durant 9 mois (de septembre 1996 à avril 1997) se propose d’apporter un témoignage de terrain sur le vécu d’une immigration dans un des derniers bidonvilles de France.
La population tunisienne en France s’inscrit dans la logique des immigrations de travail de la seconde moitié du vingtième siècle. À ce titre, elle présente de nombreuses caractéristiques communes aux autres populations originaires du Maghreb, même si elle s’en distingue sur plusieurs aspects, notamment dans son caractère plus tardif et plus discret.2
Faible jusqu’à la fin des années 1950, l’émigration tunisienne se développe au début des années 1960 pour atteindre les 206 000 résidents en 1990, et se stabiliser à 202 000 en 2000, soit 2% de l’ensemble de la population tunisienne. Alors qu’en 1954 elle ne représentait que 0,3% de la population étrangère, elle passe à 5% en 2000.
D’abord constituée essentiellement de travailleurs isolés, l’immigration tunisienne s’est profondément modifiée à partir de 1974, année de la suspension de l’immigration de travail en France. Rapidement, elle se transforme en une immigration de regroupement familial. En 19903, les travailleurs isolés ne sont plus que 20 000, soit moins de 10% de l’ensemble de la population tunisienne expatriée en France. Cela souligne les changements intervenus au sein d’une immigration qui s’est réorientée tant dans ses flux que dans sa composante.
Comme pour les autres ressortissants des pays maghrébins, à partir de cette période, cette grande vague migratoire de la période fordiste se transforme en deux grandes formes : le retour au pays et le regroupement familial. Pour une petite minorité ce sera le maintien dans la situation de travailleur isolé.
L’étude des trajectoires des migrants de Cassis montre que ces tendances sont inversées. Venus en France dans les années 1960 et au début des années 1970, ils ne seront qu’une très faible minorité à s’installer durablement dans le cadre du regroupement familial et, si un certain nombre sont rentrés au pays, ils sont une centaine (sur les 250 que comptait le bidonville au milieu des années 1980) à être restés dans le bidonville. Ce qui était un habitat d’urgence se transformera en habitat définitif. Comprendre une telle situation, c’est d’abord interroger le projet migratoire porté par cette population.
La population actuelle de Fontblanche est constituée de ces derniers contingents de ce que Abdelmalek Sayad (1977) appelle, l’immigration du deuxième “âge”. Derniers contingents, car il s’agit de ceux qui n’ont pu suivre l’une des deux autres trajectoires et qui, de ce fait, vont rester dans cette situation de l’entre-deux : ni retour, ni installation.
L’immigration des années 1960-1970 est constituée de ruraux “dépaysanisés”, ayant déjà rompu avec l’activité agricole, contrairement à leurs prédécesseurs du premier “âge”. Le second âge correspond à un projet migratoire, qui s’inscrit dans une logique de retour et qui a pour but de faire vivre une famille restée au pays tout en préparant une reconversion socio-économique grâce à l’argent épargné. Les régions qui servent de vivier à cette émigration de main-d’oeuvre sont caractérisées par des processus de déstructuration agraire avancés, comme c’est le cas à Mareth.
C’est une émigration d’adultes, généralement âgés de plus de vingt-cinq ans et mariés. Caractéristique essentielle de ces travailleurs qui viennent s’installer en France, le mariage et le début de la construction d’une famille sera le gage du retour. En optant pour cette forme de migration, celle du travailleur isolé, l’émigré s’inscrit et se projette dans une logique temporaire d’installation, celle d’un immigré. C’est ce projet qui alimentera en permanence le comportement dans la société d’accueil, limitant ainsi l’acculturation aux seules nécessités de sa vie de travailleur.
Ce qui devait être un séjour provisoire est devenu durable pour une partie de ces travailleurs. Mais les conditions de vie qui en ont découlé, notamment l’habitat, sont restées liées à cette représentation du séjour. Sur les 20 000 Tunisiens isolés en France en 1990, on peut estimer qu’environ 10 000 d’entre eux vivent dans des foyers et des chambres d’hôtel et 250 dans des habitations de fortune, dont une centaine à Fontblanche.
La rapide histoire de ce bidonville va nous permettre de voir comment s’est organisée cette population et d’apporter un témoignage sur le devenir d’une émigration qui n’a pas pu faire aboutir son projet.
Les résidents de Fontblanche sont tous originaire de Mareth. À la limite du grand Sud tunisien, Mareth est une des 7 délégations du gouvernorat de Gabès. Commune rurale de 35 000 habitants, le chef-lieu n’avait que 2500 habitants en 1975, le reste de la population se répartissant sur les 48 lieux-dits et hameaux de la commune (seuls 2 ont plus de 1000 habitants et 28 en ont moins de 200).4 Cet habitat très dispersé prend la forme de petits hameaux et rayonne sur des terroirs agricoles extrêmement morcelés. Les exploitations de petite taille n’arrivent plus à subvenir aux besoins d’une population pour qui l’émigration devient la seule alternative possible.
À partir des années 1950, un important mouvement migratoire touche cette région. D’abord dirigé vers le nord de la Tunisie, la migration des habitants de Mareth va s’orienter vers la France à la fin des années 1960. La grande caractéristique de cette migration, c’est qu’elle est essentiellement une migration d’hommes, c’est-à-dire d’adultes de 25 à 50 ans.
En 1966, quatre hommes sur dix travaillent et résident en dehors de Mareth. Le taux s’élève à environ 45% pour les 20-40 ans et à pratiquement 50% pour les 30-39 ans (soit un homme sur deux pour cette classe d’âge). Au total, l’effectif des hommes vivant en dehors de Mareth est d’environ 1200 sur une population masculine globale de 16 500 personnes dont 7100 de plus de 20 ans.5
Certes, à partir des années 1970, Gabès va connaître un notable développement économique et devenir la deuxième ville industrielle de Tunisie (port pétrochimique, un complexe industriel regroupant essentiellement des industries chimiques et de matériaux de construction). De fait, à partir de cette période, Gabès va absorber une partie importante des flux migratoires qui doublent entre 1975 et 1984. Mais cette dynamique de développement régional ne profitera pas à ceux qui sont partis travailler à Cassis.
Leur passé professionnel est celui propre à ce type de migration, ils seront ouvriers dans les BTP, au chantier naval de la Ciotat (dans les entreprises de sous-traitance) et dans les industries locales. Certains ont commencé leur parcours migratoire en région parisienne ou lyonnaise, les autres sont directement venus à Cassis.
Au moment de notre enquête, la population est composée de 92 résidents, dont 95% sont venus en France avant 1975,6 soit une installation de plus de vingt ans. 31% d’entre eux étaient déjà présents sur le site du premier bidonville au début des années 1960. Les premiers arrivants se sont d’abord installés dans un hôtel délabré de Cassis. Après leur expulsion en 1964, ils créeront un premier bidonville dans une carrière désaffectée, Doriat, qui accueillera jusqu’à 250 résidents. Ce premier bidonville détruit par un incendie, ils s’installeront, en 1969, dans une carrière voisine, plus discrète, plus éloignée des regards, à Fontblanche sur les hauteurs boisées de Cassis.
La moyenne d’âge est de 52 ans et 15% ont plus de 65 ans, le plus âgé ayant 76 ans. Seuls deux résidants ont moins de 40 ans. C’est à partir de 1985 que les effets du chômage se font ressentir et que la précarité salariale se rajoute à celle de l’habitat. En 1997, ils n’étaient que 6% à occuper un emploi permanent, 69% étaient au chômage et 21% étaient retraités. Cette situation de travailleurs précaires, entretenus par des pensions de chômage ou de retraite, va générer un système de petits boulots. La population du bidonville devient un vivier d’emplois saisonniers et occasionnels pour le marché local (petits chantiers de construction, vendange en septembre sur les vignobles voisins) et surtout comme jardiniers dans les luxueuses villas de la commune. Alternant les voyages au pays et les petits emplois, les habitants vont construire une vie discrète sur ce territoire oublié.
Le site en lui-même est en bordure de la route Carnoux-Cassis dans un vallon boisé, à l’abri des regards extérieurs. Pour y accéder, une piste carrossable partant de la route s’engage dans le vallon étroit. De part et d’autre de ce chemin principal ont été érigées les baraques dont la distribution ne semble obéir à aucune logique particulière, si ce n’est celle d’une occupation spontanée et anarchique de l’espace disponible offert par cette ancienne carrière. Frêles baraques faites de matériaux de fortune donnant l’impression de s’écrouler à tout moment, elles sont appelées “cabanons”7 par leurs occupants. Le site est toujours propre, hormis quelques carcasses de voitures, il n’y a ni déchets ni détritus qui jonchent le sol.
À y regarder de plus près, le bidonville de Fontblanche répond à une logique sociale de l’habiter, où ses résidents ont su mettre en oeuvre toute une intelligence dans l’appropriation spatiale. Logique d’autant plus intéressante à lire et à comprendre qu’elle est le résultat d’une adaptation délicate à un champ de contraintes à la fois physiques (la topographie du site), matérielles (les matériaux de construction disponibles) et surtout institutionnelles (la tolérance des autorités). Cette logique nous renseigne sur les stratégies d’une population qui apporte à travers cette forme d’habitat ses réponses discrètes et silencieuses à sa situation d’exilés comme travailleurs isolés.
Le chemin qui, depuis la route, donne accès au site, constitue l’axe principal à partir duquel s’ordonne le bidonville. Cet axe, large piste carrossable, permet en fait d’accéder à un petit entrepôt de carburant installé après l’arrêt de l’exploitation de la carrière. La piste débouche sur une petite clairière permettant aux quelques camions venant s’approvisionner à l’entrepôt de pouvoir manoeuvrer, formant ainsi une placette qui est l’espace central du bidonville à partir duquel toute la logique de distribution de l’habitat peut se lire.
Les baraques sont disposées de part et d’autre de cet axe principal. Sur le versant droit du vallon, l’alignement se fait sur une seule rangée bordant la piste. Des latrines sont installées sur les hauteurs. La proximité de la paroi rocheuse, qui à ce niveau est abrupte, a rendu difficile l’appropriation de ce versant. Par contre sur le versant gauche, là où les excavations de l’ancienne carrière ont complètement creusé la roche, un chemin grimpe en décrivant une courbe et distribue sur un habitat dont la densité est peu visible de la placette. Derrière l’alignement rectiligne de la première rangée, sur plusieurs niveaux sont distribués en forme de grappes ou d’alvéoles des groupes de cinq à dix cabanes. C’est au coeur de cet ensemble qu’est située la salle de prière, le seul local, avec celui de l’ Amicale, à être partiellement bâti en dur.
Si l’accès aux baraques du versant droit se fait directement par la piste, les habitations du versant gauche sont distribuées par des sentiers, formant un système de ruelles et de venelles épousant les sinuosités du relief. Ces sentiers, entretenus, assurent aussi le ruissellement des eaux de pluie, montrant un certain savoir pratique dans l’appropriation de la pente et d’adaptation à la topographie du lieu. Adossées au versant du mont, les habitations bénéficient d’une meilleure protection contre le vent, la pluie et le soleil.
C’est à l’intérieur d’un espace organisé revêtant les véritables caractéristiques d’un village reconstitué que s’organise la vie quotidienne. Plusieurs niveaux d’espace, correspondant aux différentes pratiques, hiérarchisent les activités, des plus collectives aux plus intimes.
Ainsi, la placette sur laquelle est situé le local de l’ Amicale, seul local raccordé au réseau électrique et à ce titre équipé d’une télévision. C’est le principal espace public du bidonville, lieu où l’on se croise, se rencontre, où l’on vient aux nouvelles et récupère son courrier que le facteur dépose chaque matin. C’est aussi l’endroit où se situe le seul point d’eau, jouant le rôle de fontaine publique.
Plus discrètement, à l’intérieur du tissu, “la mosquée” accueille aussi des pratiques collectives. Son emplacement lui confère une sacralité, synonyme d’intimité à ne pas troubler. Fréquentée par les seuls pratiquants, elle se dissimule aussi des regards éventuels de la société extérieure. Il est donc bien différent de l’espace public central, celui où est situé le local de l’ Amicale, qui lui est profane et ouvert à tous.
À l’intérieur, le tissu s’articule autour de quatre grands noyaux familiaux, à partir desquels sont distribués les cabanons et leurs occupants (frères, oncles, neveux et cousins) créant de micros espaces, ou des unités de voisinage. Des signes permettent de marquer les statuts : une “ruelle sentier” ou une “baraque chicane” indiqueront par exemple la séparation entre l’espace public et l’espace domestique, créant des privatisations de fait, une ruelle aboutit sur une impasse, ou des privatisations voulues, un groupe de cabanes disposées en fer à cheval. Ils permettent des sociabilités restreintes, comme partager un repas collectif ou un thé.
Sur la porte de la cabane sont peints un numéro et un nom d’occupant. L’habitation est le plus souvent constituée d’une pièce unique de 15 m2, à laquelle a été parfois rajouté un coin débarras, ou un coin cuisine, ou les deux à la fois.
Elle est faite de matériaux très rudimentaires : planches et cloisons de bois pour les murs, tôles, bâches en toiles et en plastiques en guise de toiture, sont les plus courants. Les baraques reposent sur des chapes en ciment, seule partie en dur que les occupants se sont permis de construire.
L’intérieur des cabanons est fruste, mais propre et fonctionnel. Le modèle-type de la cabane est constitué d’une pièce unique. Mais, avec la dédensification que connaît le site depuis plusieurs années, l’appropriation des cabanes voisines transformées en dépendance s’est développée, permettant de créer des espaces habitables plus grands ou de créer des cuisines indépendantes. Non éclairées, les pièces sont souvent tristes ; on y rentre seulement pour dormir ou préparer un repas. Dans la pièce se trouvent un ou deux lits, une armoire surmontée d’une valise ou encore une malle rangée dans un coin et sur laquelle sont posés divers ustensiles. Souvent la cabane, parfois uniquement séparée du voisin (frère, cousin, oncle) par un étroit passage, ouvre sur une petite cour aménagée et protégée de l’extérieur par une cloison en bois ou en tôle. C’est dans la cour, où parfois un arbre a été planté, que l’on fait sécher le linge, que sont entreposées les réserves d’eau et où le kanoun peut être allumé.
Devant la cabane, un pied de vigne ou un micro-jardin, d’un ou deux mètres carrés où poussent de la menthe, des épinards, de la salade ou des tomates. Peu importe si cette production maraîchère ou fruitière est insignifiante, là n’est pas le but recherché. Par ces signes discrets, il y a un marquage symbolique de l’espace, celle d’un enracinement résidentiel.
Un vécu aussi long dans des conditions particulièrement difficiles suppose une forte cohésion sociale reposant sur des règles de vie à la fois strictes et sur des solidarités profondes.
Un chef de village est désigné. Son rôle est de représenter les habitants de Fontblanche auprès des autorités françaises et consulaires, mais aussi d’arbitrer les conflits qui peuvent surgir. Il est choisi en fonction de sa capacité à représenter le groupe (savoir lire, écrire et parler) mais aussi à assurer la bonne entente. La population maintient un contact avec le consulat de Tunisie, qui à l’occasion peut servir d’intermédiaire auprès des pouvoirs publics français ; le relais étant assuré par l’Amicale des Tunisiens dont tous les habitants sont adhérents.
Des règles strictes sont édictées, notamment l’interdiction de l’alcool et de faire venir des femmes. La réception ou l’hébergement provisoire d’amis ou de parents de passage sont des pratiques tolérées mais toute nouvelle installation, ou l’introduction d’activités, telles que la réparation automobile, sont interdites. Aucun signe inquiétant vers l’extérieur et les pouvoirs publics ne doit être envoyé.
L’organisation collective se limite à l’entretien et au ramassage des ordures. Les actes de la vie quotidienne se font individuellement. Les moments de partage sont plutôt ceux des loisirs (jeux de cartes, jeu de dames, discussion), des événements exceptionnels (fêtes religieuses, décès d’un habitant) et ceux de la solidarité de tous les jours.
À travers cet habitat d’urgence, où la précarité des habitations est censée apporter la preuve de la non durabilité du séjour, on découvre la logique d’un lieu marqué par de constantes ambigutés entre l’explicite et l’implicite, le visible et l’invisible, l’éphémère et le durable.
Cette intelligence du lieu est le résultat d’un habitus qui s’est forgé dans la dure expérience du travailleur exilé et isolé, un savoir-faire, un sens pratique de ruraux transposés que les Tunisiens de Fontblanche ont su mettre en oeuvre. Fontblanche est d’abord l’adaptation d’un modèle d’habiter, celui de ruraux du sud tunisien. Mais cette transposition est amputée, car Fontblanche est un village minoré, c’est un village sans nom, sans femmes et sans enfants.
Derrière cet habitat d’urgence, c’est aussi toute l’ambiguté du dit et du non-dit, du montré et du caché, qu’il est nécessaire de comprendre. C’est tout le paradoxe de cet habitat précaire dont la signification est d’exprimer le caractère éphémère d’une installation qui pourtant n’en finit plus de durer, dissimulant ainsi une installation durable dans le provisoire. C’est précisément autour de cette contradiction entre précarité de l’habitat et durabilité du séjour que s’est construit une négociation implicite entre les autorités publiques et les Tunisiens de Cassis. Négociation fondant un équilibre dont chacun veille à ce qu’il ne soit pas rompu. Car la condition bien comprise de tous, des habitants comme des pouvoirs publics, c’est que cette installation durable reste invisible, confinée dans une discrétion, et donc un entretien permanent de l’éphémère.
Les occupants savent bien que toute violation de ces règles non écrites mais véritablement fondatrices, notamment celle de construire en dur, aurait comme signification une rupture du “contrat” et menacerait la “tolérance” dont font preuve les autorités à leur égard. Ces règles, sans doute ont-elles été clairement signifiées au début de leur installation, mais il y a bien longtemps que les autorités municipales n’ont pas eu besoin de les rappeler. C’est en tout cas ce qui ressort des différents entretiens que nous avons eus avec les uns et les autres. Ce qui les a conduits à s’interdire d’améliorer leur quotidien, eux qui, ouvriers du bâtiment pour la plupart, auraient aisément pu le faire.
Par un curieux retournement, cette tolérance des pouvoirs publics est devenue une faveur qui leur a été accordée. “Oubliés” lors des grands programmes d’éradication des taudis des années 1970, ils sont alors devenus silencieux, cherchant à tourner à leur avantage cet oubli. Conscients qu’ainsi, alors que le marché du travail ne les utilise que très ponctuellement, vivotant avec les diverses allocations, ils pourront tenir plus facilement, n’ayant pas à s’acquitter d’un loyer.
Ces “oubliés” de Fontblanche, vont paradoxalement vivre leur village reconstitué comme un lieu protecteur vis-à-vis de l’extérieur. À l’abri des regards, ils se protègent d’une altérité dont ils se méfient, mais aussi d’une société au sein de laquelle ils se savent non désirés. Le “village” devient un refuge vis-à-vis d’une société dont on ne revendique pas une intégration sociale. Justifiant après coup, leur isolement, il nous sera souvent dit à propos du regroupement familial : “quand on voit ce qui se passe dans les villes et ce que deviennent les enfants d’immigrés, on a eu raison de laisser les nôtres au pays”.
Face à la dureté de la vie en France et des aléas du marché de l’emploi, le village est un lieu de tranquillité, un lieu où l’on ne dérange personne et où l’on n’est pas dérangé. Leur réponse aura été en reconstituant leur structure villageoise dans l’exil, de ne pas se faire remarquer, d’accepter d’être les “oubliés de Cassis”, vivant à l’écart de tous et pour eux-mêmes, ce qu’ils ressentent pourtant comme un échec de leur projet migratoire.
Le rapport remis aux pouvoirs publics, avait de quoi rassurer : le bidonville ne se renouvelait pas, il ne présentait donc aucun danger. Mieux, au regard de l’âge des occupants, il allait s’éteindre de lui même. Tranquillisée, la municipalité proposera la construction d’un deuxième point d’eau pour améliorer le quotidien de la population. L’année qui a suivi notre enquête, la presse8 commencera à s’intéresser à ceux qui deviendront “les oubliés de Cassis”.9 En juin 2000, le secrétaire d’Etat au logement fait une visite sur le site et en 2005, un projet de relogement est enfin décidé dans le cadre de la réalisation d’un ensemble d’habitat mixte. En 2007, 40 ans exactement après sa création, le bidonville de Fontblanche a vécu.
Quarante des habitants du bidonville seront relogés dans une résidence sociale construite sur leur ancien “village”. Les autres sont décédés ou rentrés en Tunisie.
INSEE, Les étrangers en France, portrait social, 1994. Recensement général de la population, 1966, 1977, Tunisie.
Sayad Abbelmalek, 1977, “Les trois “âges” de l’émigration algérienne en France”, in Les Actes de le Recherche Sociale, n°15, Paris, Juin.
Zghal Riadh, 1995, Relations de travail et conditions d’immigrés, le cas des travailleurs tunisiens en France, in Les Quartiers de la Ségrégation, sous la direction de R. Gallissot et B. Moulin, Karthala, Paris.
Cassis est une commune balnéaire des Bouches du Rhône de 8 000 habitants. Le revenu moyen annuel par ménage est nettement supérieur à la moyenne nationale (25 000 euros par ménage contre 15 000) et l'immobilier est particulièrement élevé (5 500 euros le m2 contre 1500). C'est une des communes les plus riches de la région.
La présence des Tunisiens en France est réputée pour être discrète dans ses comportements et ses pratiques. Sa visibilité n'apparaît qu'à travers le personnage de l'épicier de quartier qui, généralement, a une bonne image dans la société française. Certes, la forte présence des autres nationalités maghrébines a pour effet d'accentuer cette non visibilité. Mais, force est de constater, qu'il existe un état d'esprit au sein de l'immigration tunisienne, qui tend à structurer sa conscience collective. Riadh Zghal (1995) montre que l'identité des Tunisiens en France se construit sur la base d'une valorisation de soi par rapport aux autres immigrés. Ce qui les conduit à adopter une attitude de réserve et de discrétion dans le pays d'accueil. Cette discrétion n'empêche pas les Tunisiens d'être le groupe national le plus touché par le chômage. En 1992, 34% des Tunisiens de France sont au chômage (contre 29% pour les Algériens et 28% pour les Marocains).
Données de références que nous utilisons par rapport aux besoins de notre enquête. INSEE, Les étrangers en France, portrait social, 1994.
Dans le classement des communes selon la taille de la population agglomérée, sur un total de 155 délégations, Mareth occupe le 141e rang. Ce qui souligne sa dimension profondément rurale. Recensement Général de la Population de 1966 et de 1975. Tunisie.
Recensement Général de la Population. Tunisie.
10% sont venus avant 1960, 43% entre 1965 et 1969, 42% entre 1970 et 1974 et seulement 5% après 1974.
À Marseille, le cabanon désigne généralement la petite résidence secondaire que les Marseillais utilisent pour leur week-end.
À partir de 2000, des articles réguliers sont publiés notamment par l'Humanité, le Nouvel Observateur et Libération. Un photographe publie un livre et Arte diffuse un film documentaire de 52 minutes.
C'était le sous-titre que nous avions donné au rapport.
Published 22 February 2010
Original in French
First published by NAQD 26/27 (2010)
Contributed by NAQD © Saïd Belguidoum / NAQD / Eurozine
PDF/PRINTSubscribe to know what’s worth thinking about.
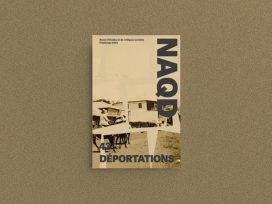
The lurid past of French colonial expulsion and incarceration: of Algerians sent to French Guiana; Jews interned in camps termed ‘battalions’; and French colonized peoples replacing convicts as forced labour.

Eurocommunism at first seemed to offer a strategy for socialist transformation in keeping with the complexities of contemporary western European societies. But by the mid-1980s its momentum had dissipated, leaving communist parties in deep crisis. Despite its political failure, however, Eurocommunism could also claim important achievements.